| Listing 1 - 10 of 63 | << page >> |
Sort by
|
Book
Year: 1962 Publisher: Brussel Ministerie van Landbouw
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Grassen (Weide-) --- Herbes de pâturage --- Klaver --- Trèfle --- 633.2/.3
Dissertation
Year: 2019 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Au cours des dernières années, les sécheresses sont plus fréquentes, les précipitations moins régulières mais plus intenses et les températures croissantes. Pour nourrir des ruminants, le pâturage s’avère être la technique la plus économique. La législation impose aux agriculteurs d’implanter des végétaux durant les périodes d’intercultures. Le prix des terres agricoles ne cesse d’augmenter. L’opinion publique souhaite que les agriculteurs raisonnent leur emploi de produits phytopharmaceutiques. Certains agriculteurs décident de diminuer le travail du sol. L’ensemble de ces facteurs oriente l’agriculture vers plus d’innovations afin de répondre aux enjeux agronomiques, économiques, climatiques et environnementaux de demain. Le pâturage des cultures dérobées par les ovins permet de répondre à certains de ces enjeux. Les cultures dérobées sont disponibles au moment où la production fourragère des prairies diminue, tant en qualité qu’en quantité. L’agriculture devenant hyper-spécialisée, ce genre de pratique permet de rétablir le lien entre éleveurs et cultivateurs. La filière ovine wallonne est très peu développée puisqu’elle compte environ 70 000 brebis en 2015 et une autosuffisance de 10,2% en 2016. L’augmentation de la production locale ne saturerait pas le marché. L’implantation de nouveaux élevages est donc possible. Cette tendance se dessine déjà avec une croissance de 44% du nombre d’élevages professionnels entre 2010 et 2015. Le pâturage des cultures dérobées semble donc être un levier au développement de la filière. C’est pour cette raison que la Région wallonne et l’Union Européenne investissent dans la recherche et l’encadrement de ce sujet. En 2017, la Région wallonne a assoupli certaines règles afin de faciliter ce type de pâturage, tout en respectant les autres réglementations. Cette étude s’intègre dans ce contexte. Deux mélanges de semence de cultures dérobées non destinés au pâturage ont été testés. Les mélanges de cultures dérobées choisis produisent-ils du fourrage de qualité et en quantité suffisante pour garantir des performances zootechniques normales pour un troupeau de brebis viandeuses en entretien ? Les résultats traduisent une différence significative entre les deux mélanges pâturés. Un des deux amène des performances traditionnelles avec un GQM de 104 g/j. L’autre ne permet, lui, aucune croissance et peut entraîner une perte de poids chez certains animaux. La taux de matière sèche des mélanges testés est en moyenne inférieur de 3 à 5 points par rapport à une prairie traditionnelle présente dans cette région. Ce qui explique en partie le manque de performances du couvert végétal. Enfin, différentes techniques d’analyses de pâtures, traditionnelles ou novatrices, ont été testées. Il apparait que, même si la culture dérobée doit être considérée comme une prairie temporaire, les techniques de mesures et d’analyses de ces prairies particulières doivent être adaptées.
Multi
ISBN: 9058082997 9789058082992 Year: 2000 Publisher: [Wageningen]: [éditeur inconnu],
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Trifolium repens --- Pâturage --- Grazing --- Système de pâturage --- Grazing systems --- Fertilisation --- Fertilizer application --- Fourrage --- forage --- Succession écologique --- ecological succession --- New Zealand
Book
ISBN: 9780415626118 9780203102909 9781136242175 9781136242212 9781138304482 Year: 2013
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Terre de pâturage --- Grazing lands --- Pâturage --- Grazing --- Pâturage en forêt --- Forest grazing --- Prairie mixte --- Mixed pastures --- Système sylvopastoral --- silvopastoral systems --- Pastoralisme --- Pastoralism --- Écologie --- ecology --- History --- Aménagement forestier --- Forest management --- Browsing (Animal behavior) --- Forests and forestry --- Landscapes --- Environmental aspects --- History. --- Europe
Book
ISBN: 9252004416 Year: 1977 Publisher: Rome : FAO,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
ecology --- Grazing --- pasture improvement --- Feed crops --- Permanent pastures --- extension activities --- Arid zones --- Semiarid zones --- FAO --- Emasar ii --- Paturage aride --- Paturage semi-aride --- tropical Africa
Book
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
ecology --- Grazing --- extension activities --- Arid zones --- Semiarid zones --- pasture improvement --- Permanent pastures --- FAO --- Development projects --- Pastoralism --- Emasar ii --- Paturage aride --- Paturage semi-aride --- Sahel --- Africa --- Sudano Sahelian Region
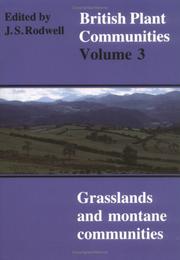
ISBN: 0521627192 9780521627191 9781107340800 9780521391665 Year: 1992 Publisher: Cambridge Cambridge University Press
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Végétation --- vegetation --- Phytoécologie --- plant ecology --- Pâturage --- Grazing --- Prairie --- Prairies --- Région d'altitude --- highlands --- Great Britain --- vegetation.
Dissertation

Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Les pelouses calcaires sont des milieux inhérents aux activités anthropiques, qui leurs permettent de se maintenir dans un état évolutif statique. Leur biodiversité exceptionnelle est donc tributaire des différentes méthodes de gestion appliquées sur ces milieux sensibles. La gestion conservatrice actuelle essaie donc de préserver ces habitats ouverts, pour un maximum d’espèces floristiques et faunistique. Cependant, certains objectifs de conservation ne sont pas en parfaite adéquation pour l’ensemble des groupes taxonomiques. Dans le cas présent, l’herpétofaune présentent des exigences écologiques qui sont parfois en désaccord avec la gestion appliquée. Les techniques de pâturage et de fauchage ont pour objectif de conserver les pelouses ouvertes, en enrayant le développement des graminées pionnières et des espèces ligneuses. Toutefois, les reptiles ont besoin d’une multitude de micro- habitats : des zones ouvertes pour thermoréguler, ainsi que des zones hétérogènes avec une strate herbacée et arbustive complexe développée afin de se réfugier des prédateurs. Ainsi, le projet de ce mémoire a été d’inventorier les espèces de reptiles de plusieurs pelouses calcaires de la région du Viroin, de Dinant et de la Lesse et Lomme. Les relevés environnementaux ainsi que les informations de gestion de pâturage ont alors pu être intégrés à cet important jeu de données, afin de mettre en lumière les possibles impacts de la gestion des pelouses calcaires sur l’herpétofaune. L’influence de méthodes de gestion a pu être démontrée : les reptiles sont sensibles à un pâturage trop intensif, qui réduit principalement les pelouses à une strate herbacée rase, non propice aux différentes espèces de reptiles.
Herpétologie --- Reptile --- Pâturage --- Fauchage --- Pelouse calcaire --- Wallonie --- Sciences du vivant > Sciences de l'environnement & écologie
Dissertation

Year: 2017 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Le développement actuel de l'agroforesterie ne se réalise pas uniquement pour les grandes cultures. En Wallonie, les éleveurs bovins en zones herbagères sont de plus en plus concernés par l'implantation et le maintien de haies ou autres ligneux en prairie, notamment via les mesures agro-environnementales mises en place par la politique agricole commune. Diverses études ont montré l'intérêt des ligneux pour les bovins en prairie. La consommation de feuilles ou de branches de ligneux par un ruminant est appelée le comportement de broutage. Le premier but de cette étude est de détecter le comportement de broutage à l'aide de la centrale inertielle d'un iPhone 4S utilisée comme capteur. Pour cela un algorithme de détection du pâturage et de la rumination (Andriamandroso et al., 2017b) est utilisé et complété sur le même schéma par ce comportement de broutage. Le second objectif est la détermination de l'emploi du temps de bovins laitiers en présence d'une haie. Le Smartphone est fixé sur le cou de l'animal à l'aide d'un licol. 41 signaux issus de la centrale inertielle et du GPS sont enregistrés à une fréquence de 100 Hz par l'application nommée Sensor Data (SD) de Wavefrontlabs. Pour l'élaboration de l'algorithme de détection, 12 vaches équipées d'un capteur ont été contenues à proximité d'une haie. Deux jours d'enregistrement ont eu lieu à Strée sur une haie de charme le 21 et 22/9/2016. Le 29/9, 2 vaches ont été maintenues le long d'une haie d'aubépine. Durant ces 3 jours, les animaux ont été observés à l'aide de caméras. Une partie de ces enregistrements ont constitué, avec les fichiers de calibration de l'algorithme de détection du pâturage, la base de données de calibration. La validation de l'algorithme pour la détection du broutage est réalisée sur base de l'ensemble de ces données. En ce qui concerne la détermination de l'emploi du temps des bovins en prairie, 12 vaches équipées d'un capteur ont été installées en prairie du 16 au 20 mai 2017. 6 vaches avaient accès à une haie et 6 autres vaches qui n'avaient pas accès à la haie pour obtenir 48 h d'enregistrement SD par animal. Les paramètres retenus pour détecter le comportement de broutage sont la moyenne par seconde de l’accélération suivant le référentiel terrestre X (g) ainsi que les écarts-types par seconde de l'accélération gravitationnelle selon x (g), de la vitesse de rotation selon x (rad/s) et de la vitesse de rotation selon y (rad/s). À ces paramètres de détection sont ajoutés la latitude et longitude pour ne détecter le broutage que lorsque l'animal est situé à proximité de la haie. L'algorithme ainsi élaboré est construit selon un schéma de type booléen. La détection du comportement de broutage, validé sur 2 haies avec 12 animaux pour une durée du comportement de broutage de 17058 s d'observations, obtient une sensibilité de 59%, une spécificité de 86,6%, une précision de 66,4% et une exactitude de 81,5%. Pour ce qui concerne l'emploi du temps des bovins en prairie, un groupe de 6 animaux sur 4 jours d'essais a en moyenne, selon l'algorithme de détection du broutage développé dans ce travail, passé 28,8% à pâturer, 16,8% à ruminer, 2,1% à brouter et 52,5% d'autres comportements sur une durée de 24 h. La détection de ce nouveau comportement ouvre des possibilités de détecter d'autres comportements à l'aide d'une centrale inertielle et d’accroître le niveau de connaissances de la relation entre les bovins et les ligneux en prairie.
Agroforesterie --- comportement --- broutage --- pâturage --- haie --- bovin --- capteur mobile --- centrale inertielle --- Sciences du vivant > Productions animales & zootechnie
Dissertation

Year: 2019 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Les enjeux actuels en production animale ont de multiples aspects, économiques, sociaux ou environnementaux. En effet, face à la faible valorisation économique du lait, l’heure est aux économies dans les exploitations. Pour ce faire, de nombreuses pistes sont de plus en plus privilégiées par les agriculteurs comme l’autonomie alimentaire pour contrer le coût élevé des aliments sur le marché, et une augmentation de l’efficience d’utilisation des aliments pour éviter le gaspillage des ressources. A travers ces enjeux, l’objectif du travail est le suivant : améliorer les performances technico-économiques des exploitations à travers une augmentation de l’autonomie de la ration et de l’efficience azotée des vaches laitières. Ce travail s’intéresse dès lors à trois exploitations laitières familiales dans la région sablo-limoneuse du Hainaut. Dans la première exploitation, on a pu constater que le pâturage des vaches présente de nombreux avantages. En effet, l’herbe pâturée est le fourrage le moins cher à produire, ce qui influence directement le coût alimentaire lié à la production laitière. De plus, l’herbe est un fourrage riche par nature avec plus de 1000VEM/kgMS et près de 100gDVE/kgMS, ce qui permet de diminuer les correcteurs à fournir aux vaches à haute production pour produire du lait. L’utilisation du pâturage a par ailleurs permis une autonomie de la ration de 88% et une efficience azotée de 36%. L’analyse de la deuxième exploitation est plus complexe. En effet, de nombreuses observations des animaux comme les boiteries, le manque de rumination ou encore le faible TB traduisent une l’acidose mais les caractéristiques nutritives de la ration comme le contenu en amidon ou encore la fibrosité peuvent en prouver le contraire. Au final les changements mis en place n’ont pas eu les effets attendus, que sont une augmentation du TB et une augmentation de la rumination des vaches. De plus, cela n’a pas permis ni d’améliorer l’autonomie de la ration, ni l’efficience azotée. L’environnement est un autre enjeu actuel majeur en agriculture. A travers les changements alimentaires mis en place dans les exploitations, l’impact environnemental de ces décisions a aussi été étudié. Cela a permis de mettre en évidence que le pâturage peut diminuer de 6% les émissions de GES d’une exploitation alors que le type de concentrés utilisés joue aussi un rôle important sur l’empreinte environnementale d’une exploitation.
vaches laitières --- efficience azotée --- autonomie alimentaire --- coût alimentaire --- pâturage --- environnement --- Sciences du vivant > Productions animales & zootechnie
| Listing 1 - 10 of 63 | << page >> |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News