| Listing 1 - 10 of 41 | << page >> |
Sort by
|
Book
Year: 1970 Publisher: Paris: Pedone,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
Year: 1962 Publisher: Paris
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
Year: 1962 Publisher: Paris Libr. Générale de Droit et de Jurisprudence
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Article
Year: 1998
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
ISBN: 2275010750 9782275010755 Year: 1982 Volume: t. 142 Publisher: Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
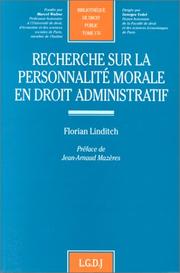
ISBN: 2275002545 9782275002545 Year: 1997 Volume: 176 Publisher: Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
La personnalité morale apparaît trop souvent comme une notion issue du droit privé qui comme telle ne posséderait qu'une faible valeur opératoire lorsqu'elle est appliquée à l'Administration. Or, son histoire en atteste, la notion prend sa source dans la théorie générale du droit et à ce titre transcende la summa divisio droit public - droit privé. Les conditions de son attribution aux groupements privés ou aux institutions administratives posent toujours la même question des conditions de la reconnaissance du phénomène collectif par l'Etat. Ce fait n'avait d'ailleurs pas échappé à la doctrine classique. Au début du XXe siècle, Michoud, Duguit et Hauriou n'ont pas été les moindres des publicistes à s'engager dans le grand débat sur la réalité ou la fiction des personnes morales. Après avoir rappelé l'importance des enjeux théoriques et politiques de la fameuse controverse, il convient de rechercher les conséquences de l'utilisation actuelle de la personnalité morale en droit administratif. Ces conséquences conduisent au constat que la notion ne peut être réduite à un simple procédé formel permettant seulement de dresser la typologie des personnes morales de droit public qui ouvre habituellement les traités et manuels de droit administratif. La raison d'être de la personnalité morale est ailleurs : elle est de permettre l'existence d'une véritable capacité juridique des personnes morales de droit public. Cette capacité juridique, comme pour les personnes morales de droit privé, fournit aux institutions administratives un titre juridique, une véritable habilitation à agir juridiquement. Grâce à elle en effet l'Administration dispose de droits subjectifs (droits réels ou personnels) dont l'efficacité est servie et renforcée par les privilèges du droit administratif. De sorte que, loin de contrarier la présentation classique de l'action administrative au travers de la notion de compétence, la capacité juridique vient prendre place à ses côtés, et apporte quotidiennement une contribution décisive à la vie des services publics.
Company law. Associations --- Administrative law --- Juristic persons --- Droit administratif --- Personnes morales --- Personnes morales - France --- Droit administratif - France
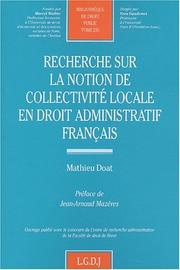
ISBN: 2275023399 9782275023397 Year: 2003 Volume: 230 Publisher: Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Les collectivités locales ont une étrange destinée. Devenues depuis les années quatre-vingt une des institutions majeures dans notre vie quotidienne, elles tendent à se fondre de plus en plus dans l'organisation administrative de l'Etat. Il semble paradoxalement que c'est au moment où s'élabore un droit des collectivités locales, que l'on renforce leur statut constitutionnel, que ces institutions paraissent vouées à disparaître. En effet, lorsque le juriste tente d'identifier juridiquement les collectivités locales, les caractères et propriétés de cette institution, il ne rencontre qu'une masse de règles enchevêtrées qui ont pour objet le local. La notion de collectivité locale échappe donc aux définitions juridiques rigoureuses comme aux grandes constructions doctrinales. Elle ne se divise pas en un certain nombre d'éléments précis et ne joue pas une fonction très claire dans le système administratif. Ces difficultés d'identification ont conduit à adopter une démarche archéologique pour comprendre comment s'est construite cette notion. On a cherché à mettre en évidence les différents types de discours qui ont participé à la production de cette notion. La méthode archéologique permet en effet de distinguer trois groupes d'énoncés, le discours ontologique, le discours administratif et le discours économique, qui constituent des équilibres stables, les véritables strates de la collectivité locale. C'est cette histoire de la notion de collectivité locale que l'on a tenté de raconter.
Book
ISBN: 2717822976 9782717822977 Year: 1992 Publisher: Paris: Economica,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
Year: 1967 Publisher: Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
Year: 1962 Publisher: Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
| Listing 1 - 10 of 41 | << page >> |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News