| Listing 1 - 6 of 6 |
Sort by
|
Film
Year: 2007 Publisher: Etats-Unis, Ghoulardi Film Company, Paramount Vantage, Miramax Films,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient le sort leur sourire. Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant : les tensions s'intensifient, les conflits éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la communauté, les croyances, l'ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison... et le pétrole.
Film
Year: 2003 Publisher: [France] : Sony Pictures,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Jusqu'à présent, l'existence de Barry Egan avait été dénuée de toute complication. Ses journées étaient partagées entre son travail et ses sept sœurs omniprésentes. Un tel emploi du temps ne lui laissait guère le loisir de se distraire et encore moins d'avoir une vie sentimentale harmonieuse. Deux événements vont peut-être amener un bouleversement de cette situation: l'arrivée d'une mystérieuse jeune femme ainsi que l'apparition d'un harmonium. L'expression « punch drunk » s'applique aux boxeurs désorientés par les coups de leur adversaire. Dans ce film, le personnage principal est cet homme, Barry Egan, sur qui l'amour s'abat avec la violence d'un direct du gauche. Paul Thomas Anderson nous avait laissé dans une certaine ivresse, il y a trois ans, avec Magnolia. Film-fleuve et film choral, oeuvre d'une liberté absolue, opéra baroque exaltant, le troisième film du jeune réalisateur-scénariste tenait du chef-d'oeuvre bouillant, du film culte instantané. Anderson lui-même avouait à l'époque qu'il ne pensait pas faire "plus" que Magnolia dans le reste de sa carrière: plus intime, plus énorme, plus beau. La page se tourne donc avec Punch-Drunk Love, où la gueule de bois qui suit les lendemains de fête prend des allures de réveil enivré après les nectars dégustés la veille. Petite île entre les continents Boogie Nights et Magnolia, Punch-Drunk Love conte une simple histoire d'amour de 96 minutes, soit en apparence l'antithèse des démesurément ambitieux films de trois heures qui ont construit sa réputation de jeune prodige. Néanmoins, la récréation de PTA conserve sa patte, véhiculée par la tribu qu'il s'est faite depuis Sydney. Philip Seymour Hoffman et Luis Guzman sont au rendez vous, même chef opérateur et même compositeur que pour ses précédents films. En outre, malgré un sujet plus minimaliste, la mise en scène du jeune réalisateur conserve son brillant, son aspect sophistiqué qui confère une véritable ampleur à sa supposée "petite" comédie romantique. "Supposée", car Punch-Drunk Love est un film en trompe l'oeil, une histoire de paradoxes. L'oeuvre d'un réveil à demi saoul où les contours des personnages se dessinent lentement, où le charme diffus se révèle peu à peu. Catalyseurs de cette formule magique: un harmonium, des boites de pudding, des peintures oniriques de Jeremy Blake et un costume bleu. Déroutant? Normal, Punch-Drunk Love, sous ses oripeaux clairs comme de l'eau de roche, est une énigme amoureuse dont les composantes sont plus farfelues les unes que les autres. Voici ce qui apparaît au réveil: le visage et la dégaine de Barry Egan (Adam Sandler), un homme comme les autres qui devient hors du commun sous le regard d'Anderson. Cette figure de proue est à l'image du film: l'apparence est simple mais la chair tourmentée. L'hommage à la comédie musicale des 40's tient dans l'esthétique technicolor lumineuse comme dans le costume coloré de Sandler qui en semble directement extrait, mais sous ce vernis, il y a un personnage engourdi, réveillé par l'irruption d'éléments hétérogènes dans son homogène existence. Parmi ceux-ci, l'irruption de la douce Lena (Emma Watson, sobre et charmante), parachutée telle une grenouille tombant du ciel dans la vie millimétrée de Barry. Barry et son appartement gris, Barry et ses soeurs harpies, Barry et ses accès de furie… La délicate mécanique d'Anderson tient du bruissement a priori anecdotique qui se répand sur une eau pas si limpide. L'histoire d'amour semble somme toute assez banale, mais elle permet à son personnage principal d'ouvrir les yeux sur sa propre existence, qu'il a subie jusque-là les yeux grands fermés. Le battement d'ailes du papillon Lena pousse l'homme-enfant Barry à un rituel de mue. On assiste ainsi à l'accomplissement d'un personnage esseulé et sans repère - car à la différence des trois précédents films d'Anderson, la figure paternelle est absente. Bravo à Jon Brion, qui suit cette évolution en composant une une sublime orchestration, où les thèmes mélancoliques et essoufflés font place aux revigorantes percussions accompagnant le réveil de Barry. Bravo également à Anderson d'être parvenu à sortir quelque peu du formol un genre (la comédie romantique) qui s'y complait si souvent, en apportant notamment une touche de gris à son rose. Punch-Drunk Love transpire l'amour que Anderson porte à ses personnages, comme dans ses précédents films, ou comme son homonyme Wes dans son récent La Famille Tenenbaum: on y rencontre des personnages un peu en marge, qui sont dépeints avec une finesse et une profondeur telle que l'attachement est inévitable. En habitué des festivals, Paul Thomas Anderson a reçu le prix de la mise en scène (partagé avec le vétéran coréen Im Kwon-Taek pour Ivre de femmes et de peinture) pour un film mineur dans sa filmographie, soit. Mais à l'image d'un Soderbergh ou d'un Fincher, il parvient à faire de son film mineur une belle réussite… Probablement la marque des tout grands.
Film
Year: 2015 Publisher: [France] : Warner Bros. Home Entertainment France,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
L’ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui racontant qu’elle est tombée amoureuse d’un promoteur immobilier milliardaire: elle craint que l’épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire… Mais ce n’est pas si simple… C’est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout comme « trip » ou « démentiel », « amour » est l’un de ces mots galvaudés à force d’être utilisés - sauf que celui-là n’attire que les ennuis. Chose étonnante: l’œuvre du romancier Thomas Pynchon, figure de la modernité littéraire américaine en activité depuis un demi-siècle, n’avait jamais été adapté au cinéma. Œuvre digressif, dense, extravagant, propre à impressionner les réalisateurs mais sans doute ne faut-il justement pas s’étonner que Paul Thomas Anderson, rompu aux enchevêtrements narratifs en tous genres, ait franchi le pas le premier – mieux vaut tard que jamais. Inherent Vice, publication récente de Pynchon (2009), suit les investigations tortueuses de Doc (Joaquin Phoenix), détective privé et junkie, dans le Los Angeles psychédélique de 1970, à la recherche d’une fille, puis d’un homme d’affaires, puis peu à peu tout simplement d’une vérité qui se dérobe insolemment à lui. Développant une confusion narrative assez repoussante, au premier abord, puis intrigante, et en fin de compte presque jouissive, libératrice, le film oscille entre décrépitude hippie et authentique bouffonnerie mais n’arrive tout de même pas à nous convaincre totalement. Il y a sept ans, la carrière (ou l’œuvre, selon la préférence) de Paul Thomas Anderson connaissait avec There Will Be Blood un soubresaut assez inespéré. Balayant tous les signes de fléchissement du sale gosse d’Hollywood, le film renversait la balance sur à peu près tous les terrains: bon accueil critique, récompenses de prestige, faveurs du box-office (providentielles pour un auteur alors de plus en plus déficitaire), etc. Mais là n’est pas l’essentiel. Un vieux soupçon selon lequel on aurait trop vite érigé ce faux génie en démiurge scorsesien, boulet traînant aux chevilles de PTA depuis ses tout débuts, s’est comme détaché de lui à cet instant. C’est à une nouvelle allure que l’auteur a pu soudain se mettre à marcher, allure moins pétaradante, pas vraiment plus rapide mais comme allégée, s’avançant librement dans les méandres de ses récits, d’une façon presque oublieuse: comme les antagonismes de There Will Be Blood qui se font et se défont (le prêtre, le frère, le fils, etc.), disparaissent les uns après les autres d’un film qui semble simplement se désintéresser d’eux; comme, encore, le balayage temporel distendu de The Master, œuvre encore plus élastique que la précédente. À un principe de fil d’Ariane (le téléphone arabe de Magnolia, rebondissant agilement d’une trame à une autre), le second temps de la carrière de PTA a substitué une écriture en sac de nœuds bien plus flottante et tortueuse, dont Inherent Vice serait sans doute le point d’incandescence. Impossible, ou presque, d’en suivre l’intrigue: l’expérience du film se résume bien vite à la contemplation d’un magma en mouvement où les personnages, les odeurs, les matières, les informations, tournoient toutes ensemble et reproduisent à l’infini la même confusion. On s’en inquiète d’abord, avant d’y percevoir une sorte de délivrance: le film défile comme un délire de malade, une nausée hallucinogène; ses frontières se dissipent, les chapitres semblent intervertis, il ne nous est suggéré en somme que de nous abandonner à ce grand dédale amnésique. Inherent Vice perd vite son cap et vogue donc au hasard des flots: pour tout horizon, un grand effeuillement de la fin des enchantements hippies. Au fil des pérégrinations de Doc, d’un asile de fous à un salon de massage, une même sensation d’euphorie fanée parcourt toute la faune du récit: des doux junkies aux brutes endurcies, des savants fous aux filles de la plage, la fête est passée et les rides se creusent. Le massacre perpétré par le clan Manson, régulièrement réinvoqué dans les dialogues comme un fait d’actualité contemporain de l’action, vient y sonner le glas du flower power: d’une utopie collective, les sixties se sont mues en une épidémie de solitude, un Styx en crue ruisselant ses dernières eaux dans les rues de Los Angeles, charriant avec elles quelques pauvres âmes hagardes qui se croisent sans se reconnaître. C’est certainement l’une des plus belles idées du film. Ainsi l’on pourrait volontiers faire d’Inherent Vice le dernier volet de cette contre-histoire de l’Amérique contemporaine qui fut le second souffle de Paul Thomas Anderson: contre-histoire entamée par la prospection démoniaque du pétrole, poursuivie dans les passions pseudo-religieuses de l’après-guerre, et achevée sur l’évanouissement morbide du psychédélisme; donc une histoire de la démence et des regrets, des utopies malades et de leurs médiocres prophètes; une histoire, également, enivrée de vapeurs chimiques (le pétrole, l’éther, l’héroïne). Mais PTA reste ce qu’il a toujours été, à savoir un excellent faiseur de séquences pourtant perdu dans ses propres films, bien meilleur performeur qu’architecte: il y a dans Inherent Vice beaucoup à savourer, pas grand-chose à retenir. Il restera tentant d’y voir une sorte de Grand Sommeil cuisiné à la marijuana et aux acides: même enquête tentaculaire qui se transforme peu à peu en spirale intériorisée par le détective, même défilement cauchemardesque des visages des suspects et des victimes, en farandole infernale. Cependant il reste étrangement impossible de ranger le film de Hawks à côté de celui d’Anderson: sans doute parce que les engrenages du premier semblent toujours mus par une intelligence et une mémoire qui manquent, bien cruellement, à la frénésie du second.
Film

ISBN: 5053083153533 Year: 2018 Publisher: [Paris] : Universal Pictures,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis) et sa soeur Cyril (Lesley Manville) règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes, jusqu'au jour où la jeune et très déterminée Alma (Vicky Krieps) les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.
Film
Year: 2013 Publisher: [Paris] : Metropolitan Vidéo,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Dans les années 1950 aux États-Unis. Freddie Quell est un vétéran de la marine qui retourne en Californie, après s’être battu dans le Pacifique. Il vit de petits métiers. Devenu alcoolique, il a des excès de violence irrépressibles. Il prépare des mélanges avec des alcools divers et des diluants qui font des ravages chez ses compagnons de beuverie. Lui-même est émacié, amer, physiquement et mentalement abimé. C'est alors qu'il rencontre Lancaster Dodd. Un soir qu'il était saoul, il monte instinctivement sur le yacht de celui qui se désigne à lui sobrement au matin comme « romancier, docteur en physique nucléaire et philosophe théoricien ». Dodd aurait besoin éventuellement d'un marin supplémentaire sur le bateau. Il vient sur le terrain de Quell en lui réclamant de son breuvage trafiqué. Puis il lui administre une séance de thérapie mentale. Quell, qui avait adopté jusque-là une position d'indifférence narquoise, devient ce jour-là un des compagnons du « Maître » car l'homme à demi-détruit qu'il était sort épanoui et transformé de la séance d'auditio. Quell participe désormais à toutes les activités du mouvement militant que dirige Dodd et fait valoir les droits de sa nature complexe et violente en agressant systématiquement les détracteurs de son patron, qui laisse faire. Quell côtoie de près les principaux dirigeants, qui le snobent. Dodd, qu'on presse de renvoyer l'inadapté, n'a de cesse d'obtenir l'amélioration de la condition de celui qu'il a taxé le premier jour de « stupide animal » tout en conservant avec lui des rapports constants de franchise et de quasi-amitié. À la fin du film, Quell entrevoit peut-être une embellie. Dodd est un idéologue ambitieux qui prétend révolutionner le mental humain et la sorte de secte qu'il dirige dans une relative paranoïa entre en conflit avec les autorités et les personnalités influentes. Après avoir écorché les pionniers américains et sapé les fondamentaux de la libre entreprise dans There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson ébranle la pax americana avec The Master, fresque aussi virtuose que déroutante sur l’Amérique de l’après-guerre et ses mentors escrocs. Aux derniers jours des combats, sur les plages du Pacifique, des marines livrés à eux-mêmes tuent le temps à coup de bastons improvisées et de litres de bière. La démobilisation leur apporte moins le soulagement d’être enfin libérés de leur devoir militaire que l’angoisse de devoir retourner à la vie civile. Figure matricielle du cinéma américain depuis le Tom Holmes morphinomane de Wellman (Heroes for Sale, 1933) jusqu’au Travis Bickle psychopathe de Scorsese (Taxi Driver, 1976), le vétéran, héros de la nation et paria de la société, incarne la face de Janus de l’Amérique. Freddie Quell appartient à cette génération d’inadaptés engendrés par la guerre, que le retour à la vie civile laisse aussi démunis que les classes laborieuses qui errent dans une Amérique moins prospère que ne le vantent ses affiches publicitaires. Un temps photographe dans une galerie commerciale aussi rutilante qu’un décor de Mad Men, le goût prononcé de Freddie pour l’alcool et la violence l’expédie bientôt vers des tâches plus avilissantes, jusqu’à ce qu’une nuit d’ivresse et d’errance le conduise à bord du navire où Lancaster Dodd, tout à la fois écrivain, magnétiseur et métaphysicien, dont la face replète et rougeaude n’enlève rien au charisme, le recueille comme un orphelin. L’époque est propice aux nouveaux gourous et Quell voit dans cet homme aussi jovial qu’imprévisible une figure de père, fédérant autour de sa « cause » (le nom qu’Anderson choisit avantageusement de donner à ce culte proprement scientologue) une clique de fidèles largement composée de bourgeoises égarées. Moins transi qu’un Robert Duvall et plus civilisé qu’un Robert Mitchum, Philip Seymour Hoffman campe un prédicateur qui joue plus volontiers de la manipulation et du paternalisme que de la transe mystique. Librement inspiré de la vie de L. Ron Hubbard, fondateur de l’église de scientologie, The Master délaisse la piste attendue du biopic et entreprend de décortiquer la filiation maudite entre le maitre et son disciple. Le moindre des talents d’Anderson est d’en confier l’interprétation à deux acteurs aussi magistraux qu’opposés dans leur jeu : l’animalité de Joaquin Phoenix en alcoolique rustre toujours sur le point d’exploser contre l’intellectualisme et la séduction de Philip Seymour Hoffman en faux prophète d’une religion infusée de mesmérisme, et qui peut rapporter gros. Rictus en berne et démarche mal assurée, Phoenix avance comme un fauve dans cet univers d’escrocs aux bonnes manières. Nul doute que le couple qu’il forme à l’écran avec Seymour Hoffman constitue l’une des alchimies les plus réussies du cinéma d’Anderson ces dernières années et The Master laisse tout l’espace nécessaire à leur performance. Au point de perdre le fil de son ambitieuse chronique: lancé dans une campagne promotionnelle aux allures de croisade, Dodd est finalement arrêté à Philadelphie et emprisonné un temps avec son turbulent protégé, qui l’abandonne à la première occasion. Malgré la durée du film, Anderson peine à dénouer la relation aussi ambiguë que fascinée qui unit les deux hommes, et la deuxième partie du film ébauche des directions plutôt incertaines, abandonnant en chemin des personnages qui auraient mérité plus de développement – comme celui d’Amy Adams, sous-employée en épouse faussement angélique dominant dans quelques scènes ahurissantes son prophète de mari. Anderson maîtrise en revanche son sujet de bout en bout quand il s’agit d’en esquisser l’atmosphère et le décor: cadres grandioses servis par un format 70 mm peu usité au cinéma, mouvements de caméra virtuoses ne laissant rien échapper du ballet cérémonieux de la haute société ou de la pantomime enragée de Phoenix, et lumière mordorée de la nuit tombant sur la baie de San Francisco composent une image impeccable avec la complicité de Mihai Malaimare Jr (directeur de la photographie sur Tetro et Twixt de Coppola). La conduite d’un récit aux temporalités multiples tient elle aussi de la prouesse, il suffit pour s’en convaincre d’observer, après un prologue dans l’ivresse exotique des derniers jours de la guerre, ce portrait féminin en plan fixe, écho aux souvenirs du marine Quell auditionné par un psychiatre avant son retour à la vie civile : on est tenté d’y voir un visage du passé, Anderson nous dupe en fait avec une ellipse qui nous mène droit à la profession de photographe qu’exerce Quell rentré en Amérique. Sans grands artifices ni pompeux flash backs, Anderson laisse ainsi apparaître en transparence le trauma d’une guerre qui vampirise encore les esprits. Là où le bât blesse pourtant, c’est dans l’épure revendiquée d’un scénario qui n’assume aucune direction, Anderson dressant le portrait d’un Pygmalion qui échoue à former son élève et noyant leur relation dans une zone d’incertitude. Le cinéaste se sera ainsi soigneusement épargné de prendre position sur la dimension sectaire du culte instauré par le sulfureux Dodd, si bien qu’il peut se targuer d’être toujours l’ami de Tom Cruise (son acteur dans Magnolia) après lui avoir montré le film. Généalogie d’une filiation abominable, The Master éprouve, sans jamais la démêler, cette intimité perturbante entre le maître et son disciple, le thérapeute et son patient, le père spirituel et son « fils ». En sorte que la farce de cet improbable couple, entre béhaviorisme dévoyé et dianétique, signe plutôt le formidable portrait d’une Amérique d’après-guerre peuplée d’âmes errantes et livrée aux charlatans.
Film

Year: 2014 Publisher: Burbank, CA Burbank, CA Warner Bros. Entertainment Distributed by Warner Home Video
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
"Set in Los Angeles in the slight future, Theodore (Joaquin Phoenix), a complex, soulful man who makes his living writing touching personal letters for other people. Heartbroken after the end of a long relationship, he becomes intrigued with a new, advanced operating system, which promises to be an intuitive and unique entity in its own right. Upon initiating it, he is delighted to meet "Samantha", a bright, female voice (Scarlett Johansson) who is insightful, sensitive and surprisingly funny. As her needs and desires grow, in tandem with his own, their friendship deepens into an eventual love for each other."--Back of container.
Artificial intelligence --- Operating systems (Computers) --- Man-woman relationships --- Authors --- Human-computer interaction
| Listing 1 - 6 of 6 |
Sort by
|
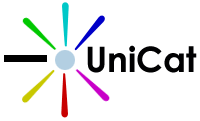
 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News