| Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|

ISBN: 2714304699 9782714304698 Year: 1993 Publisher: [Paris]: Corti,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Beckford, William --- anno 1700-1799 --- Marvelous, The, in literature --- Radicalism in literature --- Beckford, William, --- Criticism and interpretation --- Biography --- Authors [English ] --- 19th century --- Beckford, William, - 1760-1844 - Criticism and interpretation --- Beckford, William, - 1760-1844
Book
ISBN: 9782343044101 Year: 2015 Publisher: Paris : L'Harmattan,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Civil rights --- Droits de l'homme --- European Court of Human Rights.
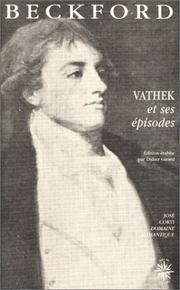
ISBN: 2714308074 9782714308078 Year: 2003 Volume: *1 Publisher: Paris: Corti,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book

ISBN: 2354122918 2354121687 Year: 2018 Publisher: Perpignan : Presses universitaires de Perpignan,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Le hasard fait bien les choses, nous dit-on. Mais il peut aussi mal les faire. C'est dire qu'il exerce un rôle non négligeable dans les domaines de l'action éthique et de la praxis esthétique. Selon Épicure et Lucrèce, le hasard serait même à l'origine de toute chose : de rerum il serait en quelque sorte la natura, pour peu que notre monde ait pris forme et consistance au sein d'un gigantesque chaos atomique, sans le concours d'un démiurge ordonnateur et législateur. « Cause fictive de ce qui arrive sans raison apparente ou explicable », aux dires des lexicographes, le hasard ne se laisse désigner qu'en creux. Il se définit par rapport à ce qu'il excède : la finalité rationnelle ou naturelle, d'un côté, le déterminisme des lois de la physique, de l'autre. Mot blanc, signifiant vide, hasard nomme cette part de l'événement qui échappe à la transcendance d'une volonté providentielle comme à l'immanence d'une nécessité matérielle. Il y a bien longtemps que les sciences de la nature – sous les coups de boutoir de l'évolution des espèces, la turbulence des fluides ou la physique quantique – ont abandonné une conception de la causalité oscillant entre la volonté rationnelle (ou inconsciente) et un strict déterminisme mécanique et légal. Voilà pourquoi, à son tour, la critique littéraire et artistique doit se mettre à penser la création esthétique en dehors des catégories de l'intentionnalité spirituelle et de l'inertie matérielle. La matière n'est pas plus inerte (in-ars) que l'auteur n'est tout puissant. La volonté et la nécessité ne recouvrent pas l'intégralité du champ de la création : la part laissée dans l'ombre et que l'on désigne au moyen du vocable hasard en appelle à de plus amples investigations.
Literary Theory & Criticism --- littérature contemporaine --- esthétique --- matérialisme
Book

ISBN: 235412399X 2914518757 Year: 2020 Publisher: Perpignan : Presses universitaires de Perpignan,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
La lettre tue, soit. Mais qu’en est-il de la parole dite vive ? Nous pensons d’habitude à ses vertus communicatives, « à la chaleur que tisse la parole/ autour de son noyau le rêve qu’on appelle nous » (Tristan Tzara). Cependant, lorsque la haine, l’indignation, la colère ou la peine investissent la langue, la chaleur devient vite insoutenable. On appelle « invective » cette fulguration de la langue, ces paroles ou ces discours agressifs visant à réduire l’adversaire, quel qu’il soit, au silence et au néant. Au lieu d’essayer de conceptualiser une notion, il s’agit ici de mettre en évidence des opérations. Ainsi, la première partie (« Présentations ») s’ouvre aux foudres de l’invective (spontanée, codifiée ou littéraire) pour tenter de décrire, et d’expérimenter, deux des processus qui la constituent : un processus irruptif au fil duquel l’affect violent « s’expulse » en passant dans la voix et la langue du furieux ; et un processus ruptif quidélie, sépare et éloigne définitivement les parties en conflit. La deuxième partie (« Littérature et Représentations ») explore plus avant les rapports entre le corps et le verbe, en suivant le cours de l’histoire culturelle occidentale. Quand le corps reprend la parole, non seulement il se met à parler de nouveau, mais aussi il reprend ce qui lui revient, ce qui vient de lui. Reprendre la parole, c’est à la fois l’amender, l’améliorer (comme on reprend des bas) et la blâmer, la réprimander, la condamner. L’invective connaît ainsi une visée proprement poétique.
Literature (General) --- littérature --- sémantique --- invective --- injure --- blasphème --- Invective --- Invective in literature --- Invectives --- Invectives dans la littérature --- Congresses. --- Psychological aspects --- Congresses --- Congrès --- Aspect psychologique
| Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News