| Listing 1 - 9 of 9 |
Sort by
|
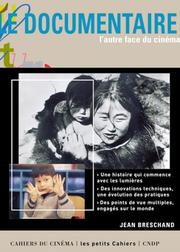
ISBN: 2866423488 9782866423483 Year: 2002 Publisher: Paris: Cahiers du cinéma,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Le documentaire est aussi vieux que le cinéma, puisqu'on peut dire que les Frères Lumière, tels Monsieur Jourdain, font du documentaire sans le savoir. Le genre recouvre des pratiques fort différentes et toute définition est forcément réductrice par rapport à leur diversité à travers le temps et l'espace. Le documentaire est une oeuvre cinématographique qui s'attache à décrire ou restituer le réel avec un traitement créatif qui se confronte directement avec le monde sans l'élaboration d'une fiction. Mais fiction et documentaire sont deux axes d'un même art qui ressaisit la réalité. Aujourd'hui les limites entre les deux s'estompent, et les deux axes ont tendance à se croiser. Par contre, la frontière entre le cinéma documentaire et le reportage, le magazine ou encore toute forme de télé-réalité tend à se définir de plus en plus clairement. La capture d'images, le "direct", le dispositif, tels que la télévision les pratique, s'éloignent de plus en plus de l'art de la mise en scène, seul susceptible de restituer la richesse et la complexité du réel. Les enjeux de cette concurrence entre le cinéma et la télévision pour structurer le regard du spectateur, sa vision du monde sont essentiels aujourd'hui et particulièrement dans l'enseignement du cinéma à l'école. Jean Breschant appuie son analyse sur des films et des cinéastes, depuis les pionniers, Lumière, on l'a dit, mais aussi Flaherty et Vertov ; Jean Vigo également, inventeur du fameux "point de vue documenté". La grande figure de Joris Ivens qui a lui seul représente un demi-siècle de cinéma documentaire, Des cinéastes qui éprouvent le besoin, pour mieux exprimer leur créativité, de passer du documentaire à la fiction et retour, comme Orson Welles, Alain Cavalier, Chantal Akerman. Les questions de la mémoire et de l'histoire sont consubstantielles au genre, de Nuit et Brouillard d'Alain Resnais à Shoah de Claude Lanzmann, en passant par l'oeuvre essentielle de Chris Marker. Les cinéastes contemporains tels Johan van der Keuken, Raymond Depardon, Robert Wiseman ou encore Jean-Louis Comolli complètent un panorama forcément non exhaustif. Un accent particulier est mis sur l'influence prégnante de l'évolution et la miniaturisation des techniques dans l'histoire du documentaire.
Cinéma --- Cinéma, matériel --- Cinéma, technique --- Documentary films
Book
Year: 1993 Publisher: Paris: ADPF,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Film
Year: 2006 Publisher: Paris: Les Films d'Ici,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Un homme et une femme se racontent leur voyage dans une ville qu'ils connaissent tous les deux sans y être jamais allés ensemble : ils découvrent comment ils pensent l'un à l'autre, ils inventent un lieu où être ensemble. Le film est constitué de photographies entièrement refilmées en studio, projetées sur un drap. Des trucages réalisés directement au cours de ce tournage mettent ces images en mouvement. Brise, respiration : ces trucages redonnent de l'air à la fixité des photos. Ce ne sont pas des souvenirs, mais l'aménagement d'un espace où respirer ensemble.
Book
ISBN: 8871805410 9788871805412 Year: 2006 Publisher: Torino Lindau
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book
ISBN: 9782873403362 2873403365 Year: 2013 Volume: *26 Publisher: Crisnée: Yellow now,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Etrange pays, étonnant cinéma... D'Henri Storck (1929) jusqu'aux années 2000, l'ouvrage met en exergue 20 films, 20 classiques du cinéma documentaire belge francophone, parmi les plus remarquables du 20e siècle. 20 films, une sélection opérée parmi 1200 oeuvres et quelque 200 documentaristes. Focus sur des événements marquants de ce pays, mais aussi exploration de quelques grandes problématiques de ce monde, ces 20 classiques sont loin d'être des oeuvres figées en ce qu'ils participent à la recherche et à l'innovation de l'art documentaire.Le titre l'indique, multiples sont les regards sur le réel, ce champ à la fois proche et sans limites, tant il peut être montré, démonté, fictionnalisé, transfiguré... Comme tout acte de création, comme tout documentaire de création. Un ouvrage inédit qui, par ses qualités de recherche et d'analyse, présente, par conséquent, les fondamentaux de l'école belge du documentaire.
Documentary films --- Documentaires --- History and criticism --- Histoire et critique --- Films documentaires --- Critique et interprétation --- Storck, Henri, --- Michel, Thierry, --- Belgium --- Hucleux, Jean olivier --- Exhibitions --- Photo-realism --- France --- Critique et interprétation. --- Michel, Thierry --- Storck, Henri --- Meyer, Paul, --- Bernhard, Edmond --- Olivier, Richard, --- 1920-2007 --- 1945-....
Book

ISBN: 9782873403881 2873403888 Year: 2016 Publisher: Crisnée: Yellow now,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
"Je suis persuadé que le cinéma peut véhiculer certaines choses qu'aucune langue au monde ne peut traduire." Artavazd Péléchian énonce en quelques mots un acte de foi dans les puissances poétiques propres au cinéma. Le cinéma invente une forme ineffable, faite de sons et d'images, que le langage ne peut épuiser. En quelques films incontournables - Au début (1967), Nous (1969), Les Habitants (1970), Les Saisons (1975-1977), Notre Siècle (1982), Fin (1992), Vie (1993) - et un livre théorique (Moei Kino / Mon cinéma) il invente un cinéma de pure émotion, entre poésie et musique, qui participe à renouveler la théorie classique du montage héritée des grands maîtres soviétiques, Eisenstein et Vertov. Dans un montage serré, ses films construisent des unités dynamiques et mouvantes pour un cinéma pleinement sonore. Enfant de l'Union soviétique, ce maître du cinéma arménien écrit une ode héroïque et lyrique aux peuples en marche, aux travaux immémoriaux des hommes, à la conquête du ciel et de l'espace. Critiques et cinéastes sont réunis dans cet ouvrage pour questionner l’œuvre de cet inventeur de cinéma qui raconte l'histoire du siècle, entre élans, espoirs et inquiétudes. Comment le cinéma de Péléchian entre-t-il en dialogue avec notre temps ?
Book
ISBN: 9782849950272 2849950270 Year: 2004 Publisher: Marseille: Images en manœuvres,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book

Year: 2016 Publisher: Crisnée Yellow now
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Book

ISBN: 9782873404178 Year: 2017 Publisher: Crisnée Yellow now
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Samuel Fuller a occupé une place centrale de la cinéphilie française et pourtant peu d’ouvrages ont été consacrés à la réflexion sur son œuvre. Faut-il y voir la conséquence d’une sorte de sidération éprouvée à la vision de films gorgés d’une paradoxale brutalité qui se heurta parfois à un aveuglement idéologique ? Peut-être. […] […] Génial raconteur d’histoires, dont certaines nourries par l’expérience de quelqu’un qui fut aux premières loges des horreurs de l’Histoire du XXe siècle (la Seconde Guerre mondiale et la découverte des camps qu’il vécut en fantassin de l’armée américaine), l’auteur du Port de la drogue occupa pourtant une position singulière à l’intérieur d’un système qui sembla accepter les obsessions et les transgressions d’une œuvre subvertissant, jusqu’à les faire exploser, les genres et les catégories d’une industrie cinématographique entrant dans une crise fatale. Les textes réunis ici, abordant d’abord la filmographie de Fuller de façon transversale et s’attachant ensuite à l’examen, tout à la fois passionné et méticuleux, de chacun des films, démontrent la fascination qu’exerce encore, et peut-être plus que jamais, un cinéma où la violence baroque s’accorde avec une douceur imprévue, un cinéma où les contradictions du monde sont rendues intensément sensibles et où, parfois, les valeurs s’inversent. Une œuvre où le choc n’exclut pas la caresse.
Cinéma --- Fuller, Samuel, --- Critique et interprétation --- Criticism and interpretation. --- Fuller, Samuel --- Critique et interprétation. --- Cinéma --- Critique et interprétation.
| Listing 1 - 9 of 9 |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News