| Listing 1 - 10 of 16 | << page >> |
Sort by
|
Book
Year: 1994 Publisher: Bruxelles: UCL,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Concernant les catégories grammaticales étudiées, nos résultats confirment ceux rapportés par Charlier et Clerebaut (1989) : les phrases passives et les pronoms anamorphiques sont incompris par la majorité des sourds. Ces résultats confirment également les principes universels, de l’acquisition du langage rapportés par Slobin (1973), c’est-à-dire d’une part que l’acquisition de la voix passive s’acquiert plus tardivement à cause de l’ordre non canonique des unités linguistiques et d’autre part que les morphèmes ambigus (ex : le pronom anamorphique «le » s’acquièrent plus tardivement que les morphèmes non ambigus.
Face à ces difficultés, la plupart de nos enfants utilisent une stratégie positionnelle ou locale observée également chez les enfants entendants les plus jeunes (ex : ils attribuent au SN le plus proche du pronom, le rôle du référent).
Un autre point de notre étude qui mérite d’être rapporté ici c’est l’impact positif de la compréhension du langage oral tant en lecture de mots qu’en compréhension d’énoncés écrits.
Ainsi, nous avons trouvé que les sourds qui ont une meilleure lecture labiale avec ou sans AKA utilisent mieux les stratégies phonographiques lors de l’identification des mots écrits et comprennent mieux le langage écrit.
Pourtant, tandis que chez les sourds intégrés les stratégies phonographiques sont déjà dominantes dés la 2ème primaire, chez les sourds non intégrés elles ne deviennent dominantes qu’à partir de la 5ème primaire. De nouveau ce sont les plus jeunes qui recourent à des stratégies compensatoires iconiques ou contextuelles tandis que les plus âgés sont centrés sur la détection des écarts orthographiques.
Le fort décalage en lecture entre les deux groupes (intégrés et non intégrés) provient d’une part des difficultés au niveau du vocabulaire plus importantes chez les sourds non intégrés et d’autre part du caractère instable et approximatif de représentations phonologiques et orthographiques de ces derniers. Ainsi, nous avons observés que les réponses contextuelles, majoritairement fournies parles sourds non intégrés, résultent du fait qu’une grande partie des items de l’épreuve de la lecture de mots n’aient pas été connus par ces enfants. D’autre part, certains d’entre eux fournissent des réponses phonographiques incomplètes, c’est-à-dire qu’ils repèrent la faute orthographique sans pourtant qu’ils puissent la corriger.
Ces résultats confirment d’une part les résultats d’Alegria et Leybaert (sous presse), c’est-à-dire que les représentations phonologiques incomplète des sourds constituent un facteur limitant de leurs habilités orthographiques et d’autre les données rapportées par Walter (1978) et Myklebust (1964) concernant la pauvreté lexicale des sourds en lecture.
Enfin, nos résultats mettent en évidence la forte corrélation existant entre la compétence des sourds en compréhension du langage oral et celle du langage écrit. De nouveau les meilleurs résultats ont été obtenus par les sourds intégrés. Pourtant, le pattern de réponses fournies par les deux groupes est très similaire : les meilleurs lecteurs et compreneurs sont les élèves les plus âgés, les meilleurs lecteurs recourent moins souvent que les mauvais aux stratégies compensatoires. La seule différence entre les sourds intégrés et non intégrés réside dans l’importance du déficit linguistique et dans la fréquence d’erreurs commises plus élevées chez les premiers. Nous pourrions dés lors émettre l’hypothèse que les sourds dans l’enseignement spécial se développent de la même façon que les sourds non intégrés mais plus lentement.
Enfin, nous avons trouvé que de façon similaire à celle des lecteurs entendants, les meilleurs lecteurs sourds utilisent la voie directe ou orthographique (lecture silencieuse avec ou sans gestes) tandis que les lecteurs les plus jeunes utilisent la voie phonologique (lecture à voix haute avec ou sans AKA ou épellation digitale).
Nous avons également observé que les meilleurs lecteurs s’intéressent plus à la signification des mots inconnus, sont plus motivés dans la tâche et utilisent une procédure analytique lors de la lecture de longues phrases en les segmentant en des unités de sens plus petites. Par contre, les mauvais lecteurs se contentent de lire seulement les mots qu’ils connaissent, donc ils ne lisent qu’une partie de la phrase, ils sont moins motivés et ils font plus d’anticipations.
Concernant la matériel utilisé, nous pensons que l’épreuve d’identification des mots, à cause du vocabulaire difficile qu’elle contient, ne soit pas très adéquate pour les sourds non intégrés de l’école primaire. Peut-être, en utilisant un autre matériel plus adéquat au niveau lexical de nos enfants, nous serions arrivés à de meilleurs résultats. Pourtant cette épreuve nous a permis de constater le retard lexical des sourds ainsi que leur façon de compenser leurs difficultés linguistiques.
Enfin, certains commentaires spontanés ou induits de nos enfants, nous ont permis de mieux comprendre leur manière, de procéder et d’interpréter les ambigüités linguistiques. Il serait intéressant, ceci dans un prochain mémoire et en utilisant le même matériel, de demander aux enfants de justifier de façon systématique leurs réponses.
Il serait aussi intéressant de retester les mêmes enfants dans une prospective longitudinale, afin de voir leur évolution à la compréhension tant du langage oral que du langage écrit. Il est bien connu aujourd’hui que les sourds acquièrent le langage oral et le langage écrit de façon similaire à celle des enfants entendant mais plus tardivement.
Plusieurs méthodes d’éducation ont été proposées afin de favoriser le développement du langage chez les sourds.
Actuellement, la plupart d’entre elles convergent à la communication entre les parents et les enfants sourds.
Le système d’aide à la lecture labiale (LPC, AKA) sont particulièrement intéressants parce qu’ils permettent au sourds de construire leur lexique interne sur base de représentations phonographiques. Ces derniers joueront ensuite un rôle important à l’acquisition de la lecture par l’enfant sourd et à la construction de représentations orthographiques.
Selon Alegria (1992), les systèmes d’aide à la lecture labiale sont extrêmement bénéfiques à l’acquisition de la lecture parce qu’ils sont génératifs et par conséquent permettent aux sourds de devenir des lecteurs autonomes. Ceci a été plus particulièrement démontré pour le LC. Par contre, le rôle de l’AKA à la lecture n’a pas encore été démontré expérimentalement. Pourtant, le fait qu’il soit un système qui favorise l’élaboration d’un code phonologique nous permet de supposer qu’il est aussi bénéfique que le LC.
Sur base de ces données, nous avons tâché d’examiner la compétence des stratégies utilisées par les sourds à la compréhension du langage oral ainsi que l’impact de cette dernière à l’identification des mots écrits et à la compréhension d’énoncés écrits.
Nous avons testé deux groupes, d’enfants sourds : d’une part, un groupe de sourds scolarisés à l’école spéciale de l’IRSA et éduqués (parmi d’autres méthodes) avec le système de l’AKA et d’autre part, un groupe de sourds intégrés à l’école ordinaire de Montjoie.
Les résultats de notre étude ont mis en évidence une meilleure compétence linguistique et métalinguistique des sourds intégrés par rapport aux sourds non intégrés. Les premiers utilisent plus efficacement que les derniers toutes les stratégies linguistiques et métalinguistiques décrites par Khomsi, tant en langage oral qu’en langage écrit et ils utilisent très efficacement les stratégies phonographiques pour identifier des mots écrits.
Par contre, les sourds non intégrés, moins compétents en langage oral et en langage écrit, essayent de compenser leurs difficultés en recourant à des stratégies telles que persévérations, réponses au hasard, désignations à partir de la saillance des images, réponses contextuelles.
Ce type de stratégies bien décrites dans la littérature ont été qualifiées comme stratégies non linguistiques ou compensatoires.
Nous avons remarqué que ce sont les plus jeunes qui recourent à ces stratégies . Par contre les sourds plus âgés utilisent plus souvent leur connaissance linguistique pour comprendre l’énoncé oral ou écrit et ils font plus d’autocorrections.
Concernant la difficulté des énoncés tant en langage oral qu’en langage écrit nous avons trouvé que les énoncés qui requièrent l’utilisation des stratégies morphosyntaxiques, méta-discursives et inférentielles posent le plus de problèmes aux deux groupes de sourds de notre échantillon. Lors de la première présentation de ces énoncés, une grande partie de nos enfants fondent leur choix sur une stratégie lexicale. Ce n’est qu’en deuxième présentation qu’ils cherchent à déceler d’autres indices et arrivent, dans la plupart des cas, à une désignation correcte.
La perception non-immédiate d’indices morphosyntaxiques du langage par les sourds, a été déjà rapportée par Charlier et Clerebaut (1989). Rondal (1982) rapporte le même phénomène chez les enfants entendants plus jeunes. Il semble alors que tant les enfants entendants que les enfants sourds comprennent d’abord la structure profonde du langage avant d’accéder à la compréhension de la structure de surface.
Book
Year: 1994 Publisher: Bruxelles: UCL,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
La surdité est un domaine qui nous intéresse depuis longtemps, ‘est pourquoi nous avons souhaité participer à cette étude dés qu’elle nous a été proposée afin d’en connaître davantage à ce sujet.
Il s’agit d’une étude exploratoire. Cochlear A.G. a élaboré une batterie de tests, le T.A.P.S. (Tests of Auditory of Speech), destinée à l’évaluation périodique de l aperception de la parole des enfants européens implantés. Actuellement, de plus en plus de données sont disponibles et permettent d’étudier l’évolution des performances de ces enfants.
Mais quelles seraient les performances au T.A.P.S. d’un enfant appareillé ? Notre étude a pour objectif essentiel de constituer un groupe-contrôle d’enfants appareillés ; nous voulions examiner ce qui ces enfants sont capables de percevoir à travers leurs prothèses. Nous avons également étudié l’influence de certaines variables pertinentes sur les performances et déterminé lesquelles de ces variables permettent de prédire une performance particulière. Enfin, une comparaison globale des résultats au T.A.P.S. des enfants implantés et des enfants appareillés a été réalisée.
Ce travail comporte deux parties :
La première partie de ce mémoire expose les bases théorique qui étayent nos investigations pratiques. En premier lieu, nous y abordons brièvement la physiologie de l’audition, différents aspects théoriques de la déficience auditive et enfin, les prothèses acoustiques et les implants cochléaires.
Nous développons, en deuxième lieu, une approche théorique des capacités perceptives d’enfants sourds profonds en fonction de certains facteurs pertinents. Enfin, les premières études comparant les capacités perceptives des implantés et des appareillés sont résumées.
La seconde partie de ce travail décrit la méthodologie et les résultats au T.A.P.S. et à l’analyse statistique. Ces résultats seront confrontés aux hypothèses ressorties de nos lectures et de nos échanges avec les professionnels de la surdité.
Deafness --- Auditory Perception --- Speech Discrimination Tests --- Child
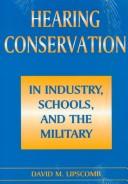
ISBN: 156593380X Year: 1994 Publisher: San Diego, Calif. Singular Pub. Group
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Dissertation
Year: 1994 Publisher: Liège : Université de Liège. Faculté de médecine (ULg). Département de clinique et pathologie médicales,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
DEAFNESS --- LABYRINTH --- HAIR CELLS --- SPIRAL GANGLION --- REGENERATION
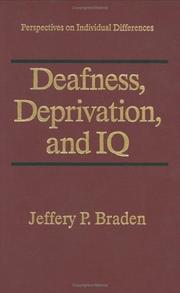
ISBN: 0306446863 Year: 1994 Publisher: New York (N.Y.): Plenum
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Deafness --- Deaf --- Deprivation (Psychology) --- Psychological aspects --- Intelligence levels --- Intelligence testing
Book
ISBN: 9789004653443 9780124274556 Year: 1994 Publisher: Leiden ;Boston Brill
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
This volume is a comprehensive source of information on the fundamentals of hearing and sound physics. Using research from 1980 onward, this book is a critical review of past and up-to-date research findings and concepts on the effects of noise on people it focuses on the psychological and physiological affects of noise on hearing and performance. This text elucidates the interrelations of the acoustical, physiological, psychological, and sociological factors that are involved in making noise a problem to individuals and societies. Also discussed are hearing loss, speech communications, annoyance, and health effects criteria for the limitation of exposures to noise in living and work areas.
Noise --- Hearing. --- Deafness, Noise induced. --- Noise pollution. --- Physiological effect.
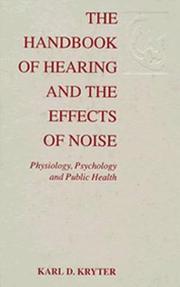
ISBN: 0124274552 9004653449 Year: 1994 Publisher: San Diego Academic Press
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Hearing --- Noise pollution --- Deafness, Noise induced. --- Hearing. --- Noise pollution. --- Noise --- Physiological effect.
Book
ISBN: 2130454771 9782130454779 Year: 1994 Volume: *12 Publisher: Paris: Presses universitaires de France,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Deafness --- Deaf children --- Surdité --- Enfants sourds --- Primitivisme --- --Art moderne --- --Art primitif --- --Primitivisme --- --Deafness --- Surdité --- Children [Deaf ] --- Language --- Hearing impaired children --- Children with disabilities --- Development --- Education --- --Children [Deaf ] --- Art moderne --- Art primitif
Book
ISBN: 2130460860 9782130460862 Year: 1994 Publisher: Paris: PUF,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Auditory perception --- Sound --- Perception auditive --- Son --- Psychological aspects --- Aspect psychologique --- Listening --- Cognition --- Auding --- Attention --- Comprehension --- Educational psychology --- Hearing --- Psychology --- Sound perception --- Perception --- Word deafness
Periodical
Year: 1994 Publisher: Washington, DC : Alexander Graham Bell Association for the Deaf,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Deaf children --- Deafness --- Persons With Hearing Impairments --- Hearing Aids --- Hearing Disorders --- Deaf children. --- Deaf --- Alexander Graham Bell Association for the Deaf --- Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing --- Alexander Graham Bell Association for the Deaf. --- Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing. --- United States. --- United States --- Deafness. --- Persons with Hearing Disabilities. --- Hearing Aids. --- Hearing Disorders.
| Listing 1 - 10 of 16 | << page >> |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News