| Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|
Book
Year: 1989 Publisher: Presses de l’Ifpo
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
À la fin de la période fatimide (969-1076), la Syrie perdit pour neuf siècles ses princes arabes. Des étrangers, souvent des Turcs, détinrent l’autorité militaire et contrôlèrent l’activité de ceux qui exerçaient un pouvoir civil ou judiciaire. D’un passé arabe qui avait été souvent glorieux, seuls demeuraient des souvenirs. Dès le VIe/XIIe siècle, des membres de l’élite urbaine consignèrent les récits de ceux qui avaient vécu ces temps révolus et recherchèrent les journaux qu’avaient tenus certains particuliers. En Égypte, grâce à des archives d’État, des historiens s’efforcèrent de retracer l’action des grandes dynasties. Si les sources primaires, archives et journaux de particuliers ont aujourd’hui disparu, des œuvres de compilation sont néanmoins parvenues jusqu’à nous. C’est à partir de ces discours, constitués principalement à l’époque ayyoubide et à l’époque mamelouke, que Thierry Bianquis, l’auteur du présent ouvrage, a pu reconstituer l’histoire de la domination fatimide sur Damas et la Syrie. Après une période d’occupation limitée, celle-ci atteint son apogée sous le règne d’un calife et imâm à la politique volontariste, al-ʿAzīz (975 à 996), également connu comme fondateur au Caire d’une des premières universités du monde, al-Azhar. Sous le commandement d’al-Ḥākim bi-Amr Allah, les Fatimides doivent ensuite faire face aux anticalifats bédouins et aux ambitions tribales mais réussissent néanmoins à conquérir Alep. À sa mort mystérieuse en 1021, al-Ḥākim se voit proclamé imâm occulté et dernière principale incarnation du prophète par certains de ses congénères chiites ismaéliens : c’est la naissance de la secte druze en Syrie.
Regions & Countries - Asia & the Middle East --- History & Archaeology --- Middle East --- Syria --- Islamic Empire --- History --- Historiography. --- chroniques --- Syrie --- Damas --- Fatimides
Book
Year: 1989 Publisher: Presses de l’Ifpo
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
À la fin de la période fatimide (969-1076), la Syrie perdit pour neuf siècles ses princes arabes. Des étrangers, souvent des Turcs, détinrent l’autorité militaire et contrôlèrent l’activité de ceux qui exerçaient un pouvoir civil ou judiciaire. D’un passé arabe qui avait été souvent glorieux, seuls demeuraient des souvenirs. Dès le VIe/XIIe siècle, des membres de l’élite urbaine consignèrent les récits de ceux qui avaient vécu ces temps révolus et recherchèrent les journaux qu’avaient tenus certains particuliers. En Égypte, grâce à des archives d’État, des historiens s’efforcèrent de retracer l’action des grandes dynasties. Si les sources primaires, archives et journaux de particuliers ont aujourd’hui disparu, des œuvres de compilation sont néanmoins parvenues jusqu’à nous. C’est à partir de ces discours, constitués principalement à l’époque ayyoubide et à l’époque mamelouke, que Thierry Bianquis, l’auteur du présent ouvrage, a pu reconstituer l’histoire de la domination fatimide sur Damas et la Syrie. Après une période d’occupation limitée, celle-ci atteint son apogée sous le règne d’un calife et imâm à la politique volontariste, al-ʿAzīz (975 à 996), également connu comme fondateur au Caire d’une des premières universités du monde, al-Azhar. Sous le commandement d’al-Ḥākim bi-Amr Allah, les Fatimides doivent ensuite faire face aux anticalifats bédouins et aux ambitions tribales mais réussissent néanmoins à conquérir Alep. À sa mort mystérieuse en 1021, al-Ḥākim se voit proclamé imâm occulté et dernière principale incarnation du prophète par certains de ses congénères chiites ismaéliens : c’est la naissance de la secte druze en Syrie.
Regions & Countries - Asia & the Middle East --- History & Archaeology --- Middle East --- chroniques --- Syrie --- Damas --- Fatimides --- Syria --- Islamic Empire --- History --- Historiography.

ISBN: 2130423930 2940549613 9782130423935 Year: 1989 Volume: vol *10 Publisher: Paris: PUF,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Ces dernières années, certains événements spectaculaires ont révélé au grand public l'existence d'une dimension islamique des relations internationales. Mais cette « révélation » n'a pas été suivie par un effort de réflexion systématique sur le sens, les origines, les aspirations de cette diplomatie islamique qui semble défier l'ordre international. L'objet de cet ouvrage est précisément de pallier, dans la mesure du possible, cette carence. Il cherche à montrer que cette action diplomatique n'est pas uniquement un essai d'investissement de la scène internationale par nécessité révolutionnaire, ou la recherche d'un moyen de consolidation d'une légitimité, mais qu'elle procède aussi en se fondant sur une vision originale, en recourant à un cadre de référence particulier et en utilisant des méthodes qui lui sont propres. Après avoir présenté, dans une première partie, les liens qui peuvent exister entre l'islam et les relations internationales en général, l'ouvrage, tout en tenant compte du courant islamique transnational, est centré essentiellement sur la politique extérieure de la République islamique d'Iran, unique exemple, jusqu'à présent, d'État islamiste, clérical et révolutionnaire. Les aspects doctrinaux de la diplomatie de l'Iran islamique sont analysés, les relations du régime khomeyniste avec les grandes puissances et les pays de la région sont évoquées pour déboucher sur une appréciation critique d'une décennie d'intenses activités sur la scène internationale.
Islam and politics --- Islam and world politics --- Islam et politique --- Politique mondiale --- Aspect religieux --- Islam --- Iran --- Politics and government --- Politique et gouvernement --- Foreign relations --- Regions & Countries - Asia & the Middle East --- History & Archaeology --- Middle East --- 327.39 <=927> --- 327 <55> --- -327.39 <=927> --- -Regions & Countries - Asia & the Middle East --- -Islam and politics --- 1979-1997 --- Iran - Foreign relations - 1979-1997 --- relations internationales --- diplomatie --- politique étrangère --- religion --- khomenysme

ISBN: 0585174237 9780585174235 0890963444 Year: 1989 Volume: 11 Publisher: College Station : Texas A & M University Press,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
Korean War, 1950-1953 --- Regions & Countries - Asia & the Middle East --- History & Archaeology --- East Asia --- Campaigns. --- Campaigns --- China. --- Chiwŏnʼgun (China) --- Chinese People's Volunteers --- Chūgoku Jimmin Shigangun --- Chung-kuo jen min chih yüan chün --- Chungguk Inmin Chiwŏnʼgun --- 中囯. --- 中国. --- 中國.
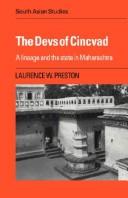
ISBN: 0521047773 0511983271 0521346339 0521056187 Year: 1989 Publisher: Cambridge : Cambridge University Press,
Abstract | Keywords | Export | Availability | Bookmark
 Loading...
Loading...Choose an application
- Reference Manager
- EndNote
- RefWorks (Direct export to RefWorks)
This innovative study of the power of lineage in India across two centuries examines some of the traditional social structures which transcended so successfully the political upheavals of British rule. Under the Maratha Kingdom, the Devs occupied a privileged position in the ritual, social and economic hierarchies of the state from the 1620s onwards, their continuing influence stemming principally from obtaining grants of rent-free land around Pune and successfully maintaining this inheritance from generation to generation. With the British conquest of Maharashtra in 1818, the close relations between state and privileged subject were slowly broken and by the 1850s, the British sought to settle the Devs' landed rights. Basing their inquiries on preconquest vernacular documents, they became entwined in disputes over the tenure of the Devs' lands and the mode of inheritance within the lineage that reveal a telling ignorance of the customary relations between the Indian State and its privileged subjects.
Land tenure --- Regions & Countries - Asia & the Middle East --- History & Archaeology --- South Asia --- Agrarian tenure --- Feudal tenure --- Freehold --- Land ownership --- Land question --- Landownership --- Tenure of land --- Land use, Rural --- Real property --- Land, Nationalization of --- Landowners --- Serfdom --- History. --- History --- Cincvad, Devs of. --- Maharashtra (India) --- Social Sciences --- Anthropology
| Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|

 Search
Search Feedback
Feedback About UniCat
About UniCat  Help
Help News
News